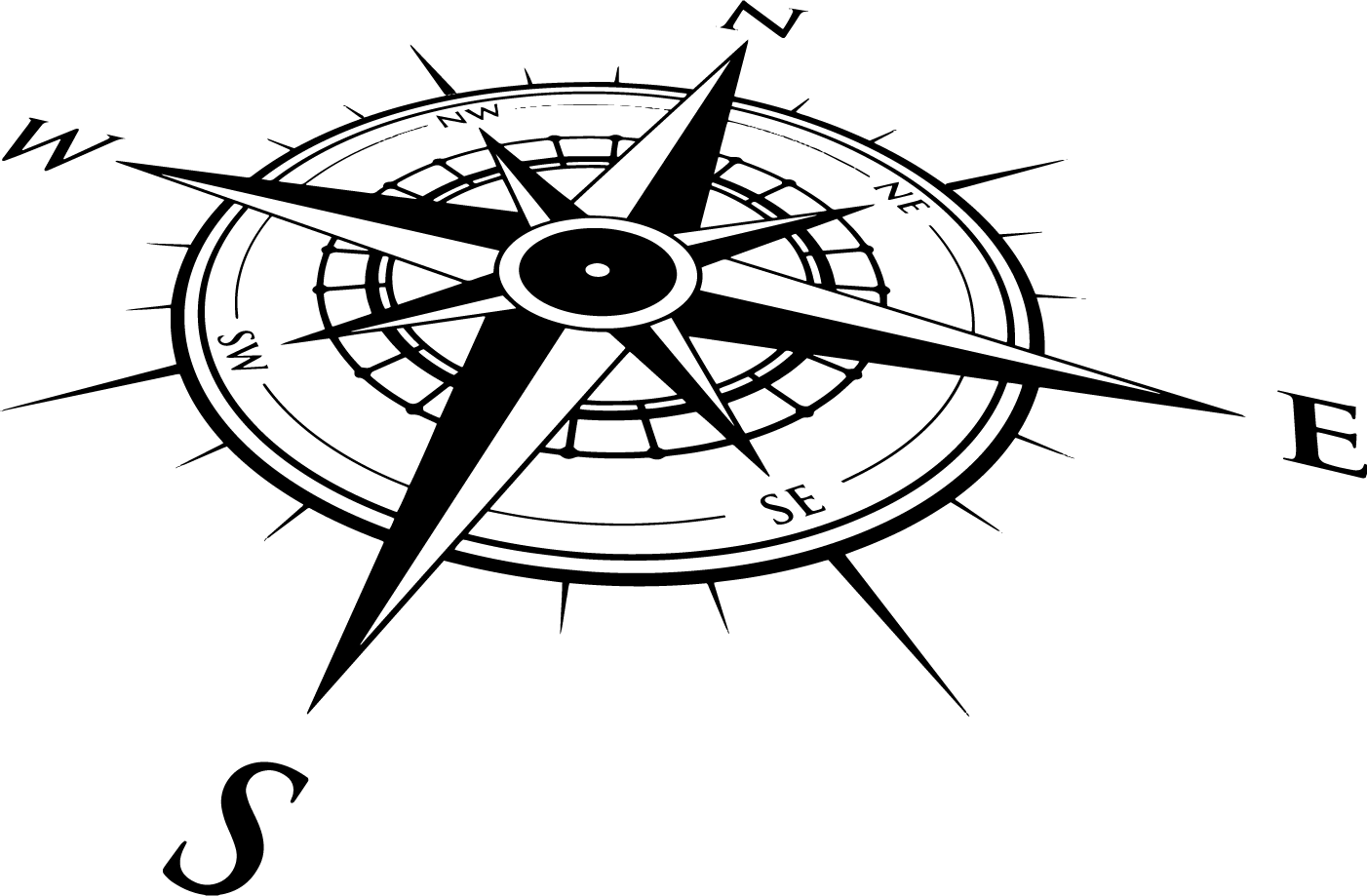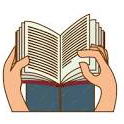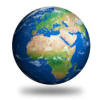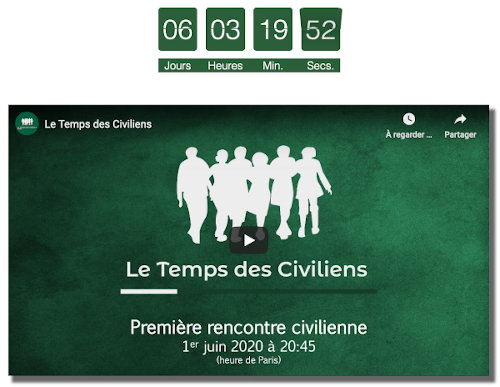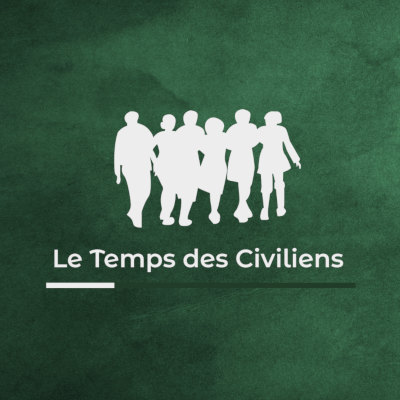Le courage de défendre le vrai christianisme et non celui de façade
- Écrit par : Rudolf Steiner
- Catégorie : Pensées anthroposophiques
(...) Nous vivons à une époque qui a sombré dans la catastrophe parce que les êtres humains ont fait suffisamment preuve de lâcheté pour ne pas exposer extérieurement ce qui pourtant vit plus ou moins en eux intérieurement. Notre catastrophe est d'origine spirituelle, comme nous l'avons souvent répété. Et nous n'en sortirons pas si nous ne nous tournons pas vers l'esprit de la vérité qui cherche, dans la vision de l'esprit, la force qui elle seule, et non une autorité ecclésiastique, octroie le droit d'imprimer (l'imprimatur) (...)
La perte de toute vénération face aux énigmes de la vie. Pour quelle raison ?
- Écrit par : Rudolf Steiner
- Catégorie : Pensées anthroposophiques
(...) Dans la machine que nous construisons, le mécanisme nous est totalement transparent. L'être humain a donc édifié sa connaissance du monde sur le modèle de la technique ; il en a tiré sa conception du monde et, pour lui, l'univers est une grande machinerie. (...)
Nietzsche et Steiner à la fin de l'Âge obscur
- Écrit par : Christian Lazaridès
- Catégorie : Articles

«(...) Nous avons donc affaire à une personnalité en qui s'opposent deux forces puissamment contradictoires : la dépendance aux systèmes matérialistes, voire mécanistes, de l'époque, mais en même temps la tendance infraconsciente nourrie par l'esprit, de combattre de tels systèmes : une dangereuse dualité si une certaine élévation du niveau de conscience n'est pas effectuée, si, à un moment donné, un lien conscient ou une confrontation pleinement consciente n'a pas lieu. (...)»
Celui qui ne se pose pas la question du sens de la vie refuse l'esprit
- Écrit par : Rudolf Steiner
- Catégorie : Pensées anthroposophiques
(...) Lorsqu'on s'est habitué au questionnement scientifique actuel, on peut certes dire qu'il n'est pas nécessaire de se poser la question du sens de la vie. On vit sans se poser cette question. On n'a pas besoin de se la poser si l'on considère que c'est une question arbitraire. Or on ne se la pose pas par pur arbitraire, mais on remarque, ou on devrait remarquer, que si l'on ne trouve pas de sens à la vie celle-ci devient absurde. (...)
Rythmer l’écoute de soi et de l’autre, un art pour cultiver la paix en le monde
- Écrit par : Alexandre Walnier
- Catégorie : Articles
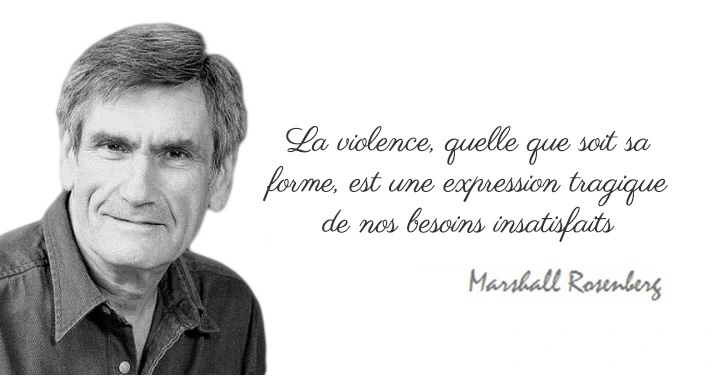
« (...) Mettre de la créativité dans la rencontre avec l’autre afin d’accompagner au mieux les conflits dans une relation « gagnant-gagnant » (...) »
En règle générale, pour parler de l’immortalité, on fait appel au plus subtil des égoïsmes en l'être humain, celui de désirer la vie après la mort
- Écrit par : Rudolf Steiner
- Catégorie : Pensées anthroposophiques
(...) Le désir de vie après la mort existe dans les formes les plus diverses en l'âme humaine et il nourrit un subtil instinct d'égoïsme. On en appelle ainsi à l'instinct humain d'immortalité, et, ce faisant, on cultive en lui la croyance en l'immortalité après la mort. On ne pourrait jamais nourrir la même croyance en parlant de l'éternité de l'âme humaine avant la naissance ou la conception. (...)
Impact des pratiques agricoles conventionnelles, biologiques et biodynamiques sur la vie microbienne des sols - Vidéo
- Catégorie : Vidéos sur l'agriculture biodynamique

Dans le cadre d’un wébinaire, Lionel Ranjard, directeur de recherche à l’INRAE de Dijon, UMR Agroécologie, a présenté le 12 novembre 2020 les premiers résultats d’une étude d’envergure sur la biologie des sols en viticulture.
Le projet EcoVitiSol a été mis en place pour répondre à la question des effets de la biodynamie sur la qualité biologique des sols, un thème pour lequel il existe peu de références au sein de l’INRAE ou d’autres organismes de recherche, en comparant des modes de production (conventionnel, bio et biodynamie).
Idéalisme contre antisémitisme
- Écrit par : Rudolf Steiner
- Catégorie : Pensées anthroposophiques
(...) Nous voulons de nouveau un idéalisme. Non pas un idéalisme confus que ne crée que l'imagination débridée, mais un idéalisme qui repose sur la connaissance et la culture. Kunowski se fait le porte-parole d'un tel idéalisme. Il est significatif qu'il devient de ce fait tout naturellement l'adversaire de l'antisémitisme ennemi de la connaissance et de la culture, de l'étroite « germanité ».
L’antisémitisme, une insulte à toutes les conquêtes culturelles de l'époque moderne (Ahasver)
- Écrit par : Rudolf Steiner
- Catégorie : Pensées anthroposophiques
(...) Il n'y a jamais eu pour moi de problème de Juifs. Mon évolution allait aussi dans un sens tel que jadis, à l'époque où en Autriche une partie des étudiants nationaux devint antisémite, cela me sembla être une insulte à toutes les conquêtes culturelles de l'époque moderne. Je n'ai jamais pu juger l'homme autrement que d'après les qualités individuelles, personnelles, du caractère que je connais en lui. (...).
Un antisémitisme honteux
- Écrit par : Rudolf Steiner
- Catégorie : Pensées anthroposophiques
(...) Celui qui a des yeux ouverts sur le temps présent sait qu'il est inexact de penser que le lien d'appartenance des Juifs entre eux est plus fort que leur lien d'appartenance aux tendances modernes de la culture. Même s'il a semblé en être ainsi ces dernières années, l'antisémitisme y a contribué pour une part essentielle. Celui qui a vu comme moi avec horreur les dégâts causés par l'antisémitisme dans le cœur de nobles Juifs a dû en venir à cette conviction. (...). L'antisémitisme n'est pas seulement un danger pour les Juifs, il l'est aussi pour les non-Juifs. Il est issu d'une disposition d'esprit qui ne prend pas au sérieux le jugement sain, droit. Il encourage une telle disposition d'esprit.. (...).
Guyau et Nietzsche sur la Côte d’Azur
- Écrit par : Christian Lazaridès
- Catégorie : Articles

«(...) ce dialogue philosophique entre Guyau et Nietzsche nous entraîne vers des hauteurs inattendues. Or, de l'autre côté — et ce sera peut-être là surtout l'apport de cet article — ce rapprochement-opposition des pensées va se doubler, au niveau le plus concret de la vie physique, d'un rapprochement géographique des deux penseurs, sans que ceux-ci en aient eu conscience. En effet, entre 1883 et 1888, Guyau et Nietzsche vont pendant vingt-six mois se frôler, si l'on peut dire, à Nice et à Menton (...)»
L’anthroposophie comme une forme de conscience
- Écrit par : Jost Schieren
- Catégorie : Articles

« (...) Dans son œuvre philosophique de jeunesse, Steiner s'est opposé au réalisme naïf, qui parle d'une réalité objectivement existante sans la participation du sujet connaissant. Cela vaut dans le même sens pour l'anthroposophie et pour la réalité spirituelle dont elle ouvre l’accès. Aussi un réalisme métaphysique naïf, sous la forme d'une croyance pseudo-religieuse et pieuse en l'Ange, au Christ et aux êtres élémentaires, n'est-elle pas conciliable avec une spiritualité moderne post-Lumières telle que la défend l'anthroposophie. L'expérience moderne de l'esprit est toujours aussi un acte d'une Individualité » (...).
Actions de Lucifer et d’Ahriman dans l’être humain. Un concept qui masque l’action d’Ahriman: le «hasard»
- Écrit par : Rudolf Steiner
- Catégorie : Pensées anthroposophiques
(...) J'ai dû vous montrer aujourd'hui d'une façon détaillée comment Lucifer engendre l'illusion en dedans et comment Ahrimane se mêle aux perceptions extérieures et conduit à la Maya ; comment c'est un effet de Lucifer quand l'homme se leurre sur de faux motifs et comment les idées fausses à l'égard du monde des apparences, l'illusion par Ahrimane, nous font croire au « hasard » (...).
Le mouvement anthroposophique à l'épreuve de la peur: quelles pistes pour essayer d'y remédier ?
- Écrit par : Olivier Prost
- Catégorie : Articles

«(...) Face aux crises qui se succèdent, une émotion a tendance à se présenter régulièrement en nous, celle de la peur. Devant celle-ci, il y a souvent trois attitudes qui sont adoptées, d'un point de vue comportementaliste, chez les animaux : (...). Ce sont également ce type de réactions que suivent bien souvent les hommes. (...)»
"Républicaine, non pas démocratique"
- Écrit par : Ernst Lehrs
- Catégorie : Articles

«(...) Qu'est-ce qui distingue une constitution républicaine d'une constitution ancienne théocratique hiérarchisée ? Et à quoi pensait Rudolf Steiner quand, la distinguant d'une constitution démocratique, il parlait justement d'une constitution «républicaine» ? Comme nous le savons, l'ordre social aux origines de l'humanité était purement vertical et était déterminé par une direction suprasensible venant d'en haut. (...) À la place de cet ordre ancien, apparurent pour la première fois en Grèce la démocratie et à Rome la république. (...)»
À quel être se relierait-on dans le cadre d’une religion mondiale ?
- Écrit par : Olivier Prost
- Catégorie : Articles

«(...) Afin de pouvoir souscrire sans réserve à l’idée de religion mondiale, une question fondamentale peut toutefois apparaître : A quel être se relierait-on dans le cadre d’une religion mondiale ? (...)
(...) Prenons donc l’hypothèse inverse, celle où la religion mondiale ne nous relie pas à Dieu. Mais alors, à qui nous relie-t-elle ? N’y aurait-il pas le danger de voir s’élever un pouvoir absolu ? La paix, à quel prix et sous quel pouvoir ? (...)»
Que se passe-t-il en chaque individu humain lorsqu'il passe par un processus d'initiation et que se passe-t-il pour la terre lors du Mystère du Golgotha ?
- Écrit par : Rudolf Steiner
- Catégorie : Pensées anthroposophiques
(...) les représentations symboliques et rituelles du drame de l'évolution humaine exerçaient une action très forte sur les néophytes [c'est-à-dire les candidats à l'initiaiton dans les anciens Mystères ; NDLR]. Or ce qui se trouvait au centre de tous les rites et de la symbolique pratiqués dans les mystères, c'était l'approfondissement de la connaissance du mystère de ce qui se passe lors de la mort du corps physique, grâce à des épreuves de l'âme conduisant à l'éveil aux mondes supérieurs. La manière dont on pratiquait l'initiation pour susciter l'expérience intérieure du néophyte dans les mystères antiques avait une grande ressemblance avec ce qui s'est passé ultérieurement lors du mystère du Golgotha. (...)
- Que requiert la compréhension du Mystère du Golgotha, à l’époque ACTUELLE ?
- L'humanité occidentale actuelle, à la traîne de l'Amérique, sombrera dans la barbarie si elle ne comprend plus le mystère du Golgotha
- On ne peut pas imaginer plus grande tyrannie que celle qui veut refuser l'étude d'un domaine qu'elle n'a elle-même jamais étudié et se refuse à le faire
- Au fond la simple croyance à la réincarnation et au karma ne conduit pas à grand-chose
- De la manière particulière de lire la Philosophie de la liberté - La lutte de Rudolf Steiner pour une «contemplation intuitive immédiate et correcte de ce qui est anthroposophique»
- L’essence (très) problématique du kantisme (et son amalgame grossier avec la pensée de Rudolf Steiner)
- Comment l'âme peut-elle surmonter sa détresse présente ?
- Le caractère entièrement public de l’anthroposophie et la nécessaire différenciation entre dilettantes et experts
- Se présenter dans le monde sous le signe de la pleine vérité
- Débutants ou «confirmés» ?
- Mouvement de l'Agriculture Biodynamique - Vidéos
- Le Conseil de Déontologie Journalistique et de Médiation considère que France 2 n’a pas respecté certaines règles déontologiques (reportage du 3/11/2022 sur la pédagogie Steiner)
- Création d'un « Groupe Relais »
- Les deux questions fondamentales à la base de la Philosophie de la Liberté
- Poser clairement le problème de la Liberté : réalité ou illusion ?
- Le penser repose... sur lui-même !
- La théorie de la relativité conduit à faire les premiers pas dans la science de l'esprit... si elle est pensée de manière conséquente
- Un point de vue sur l'évolution spirituelle de l'humanité au cours de la succession des civilisations
- L’anthroposophie suspecte selon la Miviludes, une bonne nouvelle?
- Ensemble, soutenons la pédagogie Steiner-Waldorf pour l'avenir de nos enfants